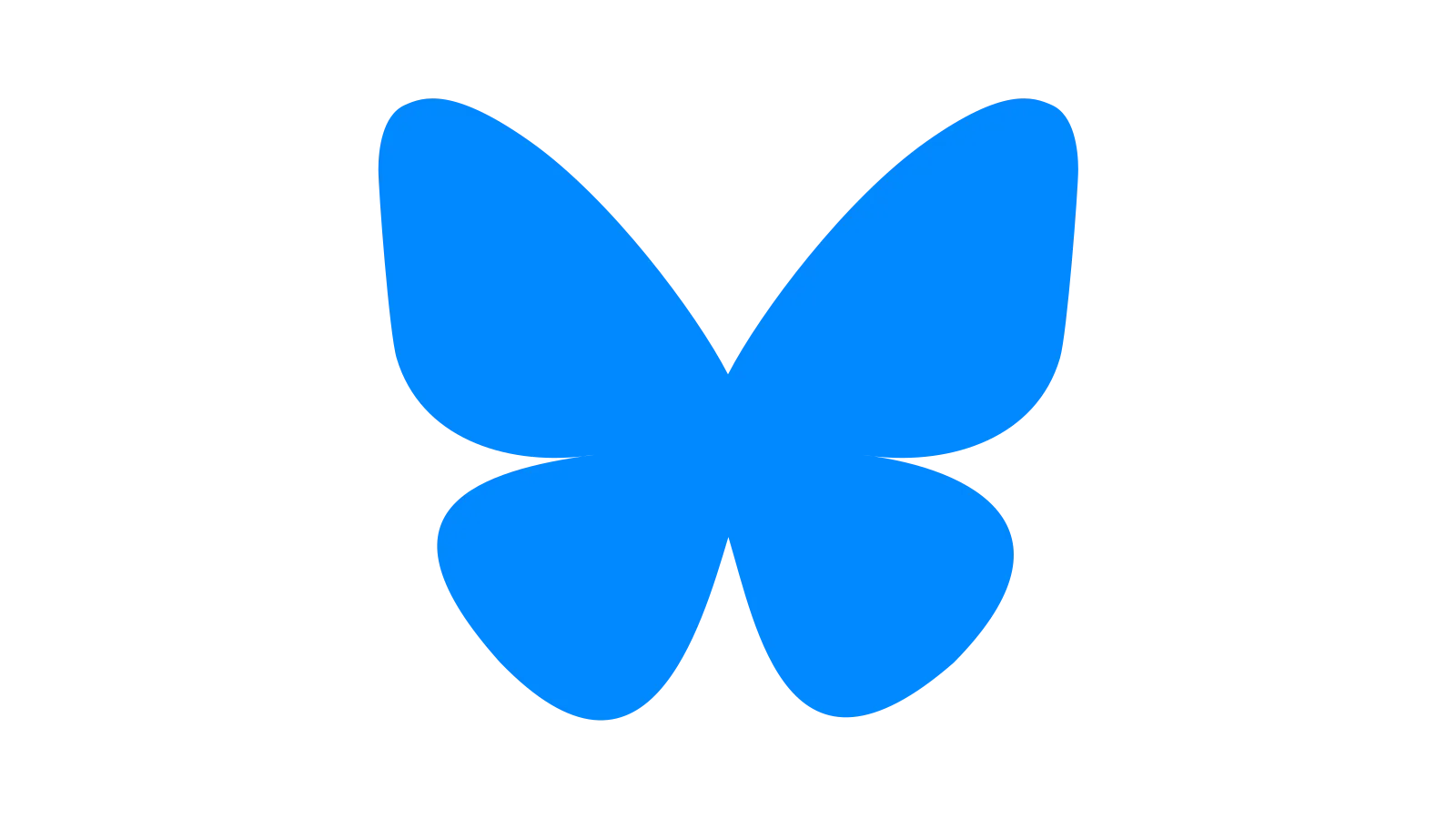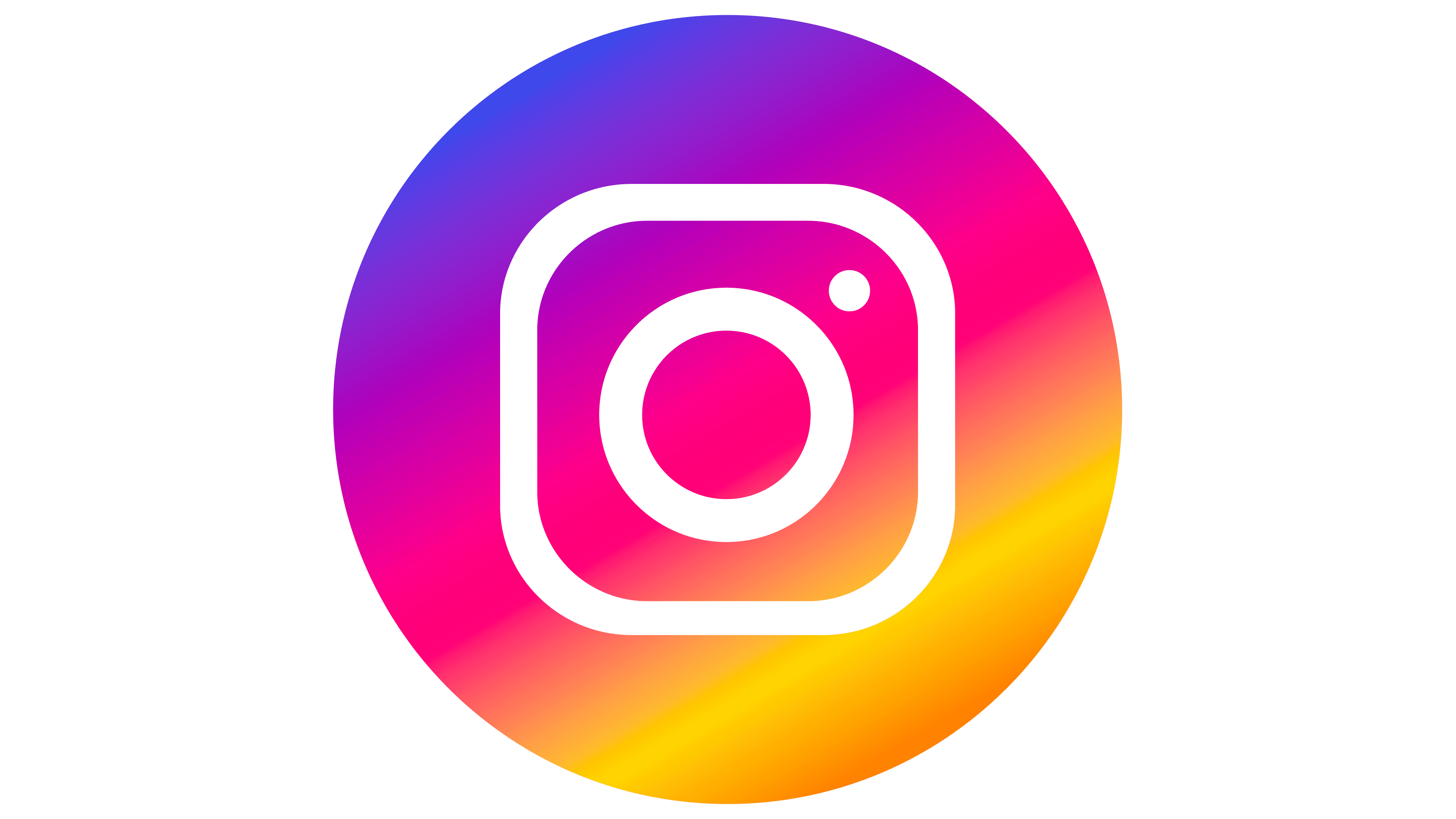HARVEST
Walter Thirsk, citadin devenu fermier, Charles Kent, seigneur un peu perdu, et les paysans de son domaine, coulent tous une existence paisible aux confins d’un Eden luxuriant lorsque se profile la menace du monde extérieur. En sept jours hallucinés, les habitants de ce village sans nom vont assister à sa disparition.
Critique du film
Comme Terrence Malick ou encore Andrea Arnold, la réalisatrice grecque Athiná-Rachél Tsangári partage une appétence manifeste pour les sensations provoquées par les textures, les matières et les sons, captés le plus naturellement possible pour en ressentir tous les effets. Avec une apparence hirsute et rugueuse, Harvest est un film brut, une affaire de contact qui ne recherche pas le confort. Pourtant, la contradiction apportée par une lumière douce (là aussi, quasi uniquement naturelle) et une image soignée donne au résultat un film étonnamment sensoriel.
C’est un peu la vision « premier degré » du Village de Shyamalan, une version dénuée de cynisme qui ne veut pas faire la maline, ni donner lieu à une multitudes de théories plus ou moins plausibles. Le malheur qui s’abat sur ce village-ci n’est pas surnaturel et rôde encore moins autour des habitations de fortune avec une silhouette effrayante. Malgré une direction artistique tout droit sortie de tableaux flamands du 16e siècle, la réalisatrice imagine l’arrivée du capitalisme ravageur dans un lieu qui en serait a priori protégé. Elle envisage ce phénomène comme une submersion, un cyclone ravageur qui fait des plus précaires ses premières et uniques victimes.

Avec un naturel confondant, Caleb Landry Jones évolue, crinière au vent, dans cette topographie comme s’il était chez lui, comme revenu à l’état sauvage. Après son tour de force dans Nitram, l’acteur américain prouve décidément qu’il est très à son aise dans les environnements solitaires et reclus et offre, avec ce rôle très charnel, une nouvelle facette de son jeu.
Outre l’arrivée d’un système économique injuste qui traquerait ses cibles jusque dans les coins les plus reculés, on peut voir dans cette allégorie du phénomène de gentrification un plaidoyer pour la protection de son territoire et, de manière plus large, une invitation à la réflexion sur les inégalités et la notion de propriété. Le fait que la réalisatrice ait volontairement choisi de ne pas dater son récit amplifie ce sentiment de ce régime comme nuisance atemporelle.
Bande-annonce
16 avril 2025 – D’Athina Rachel Tsangari