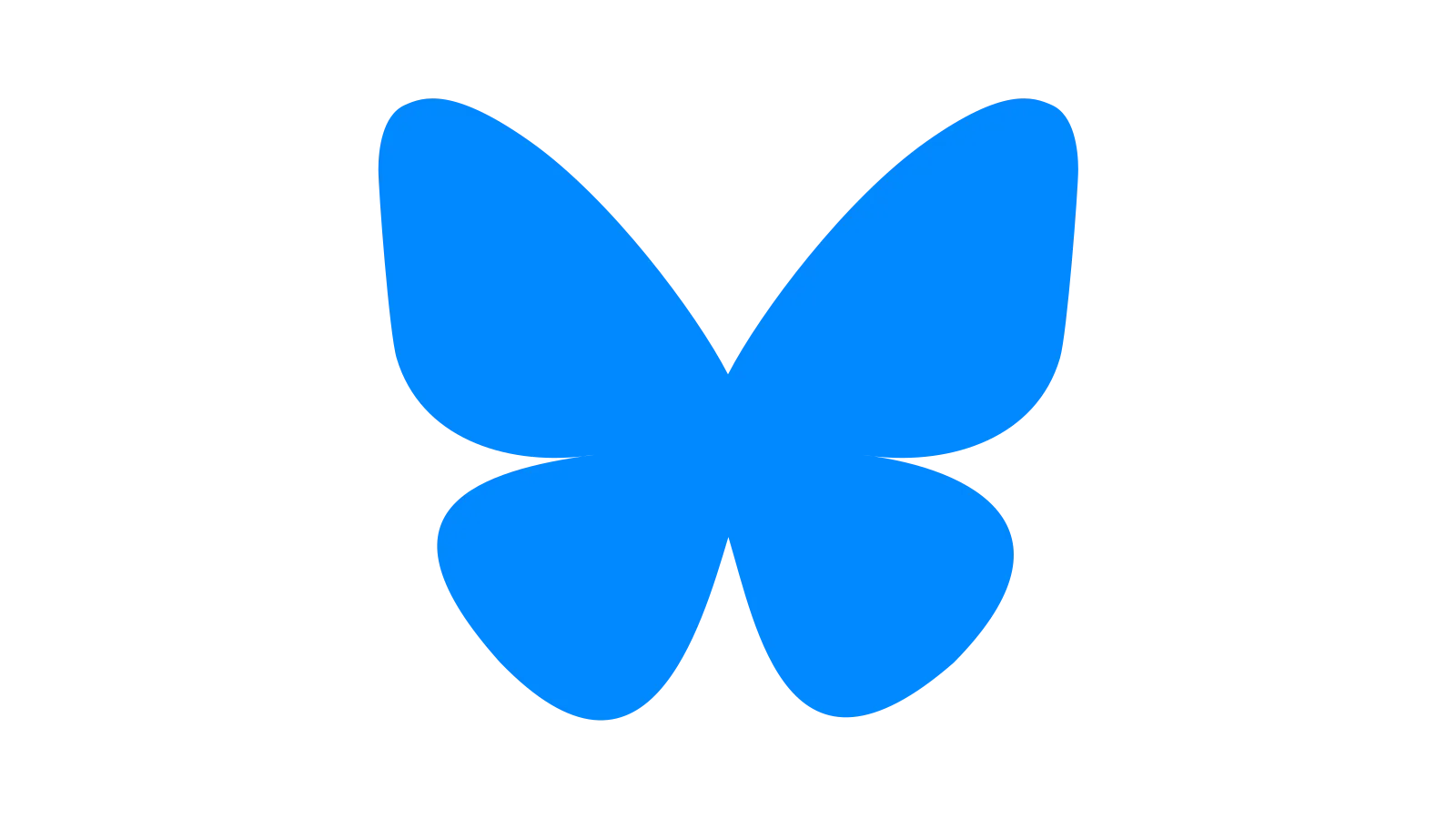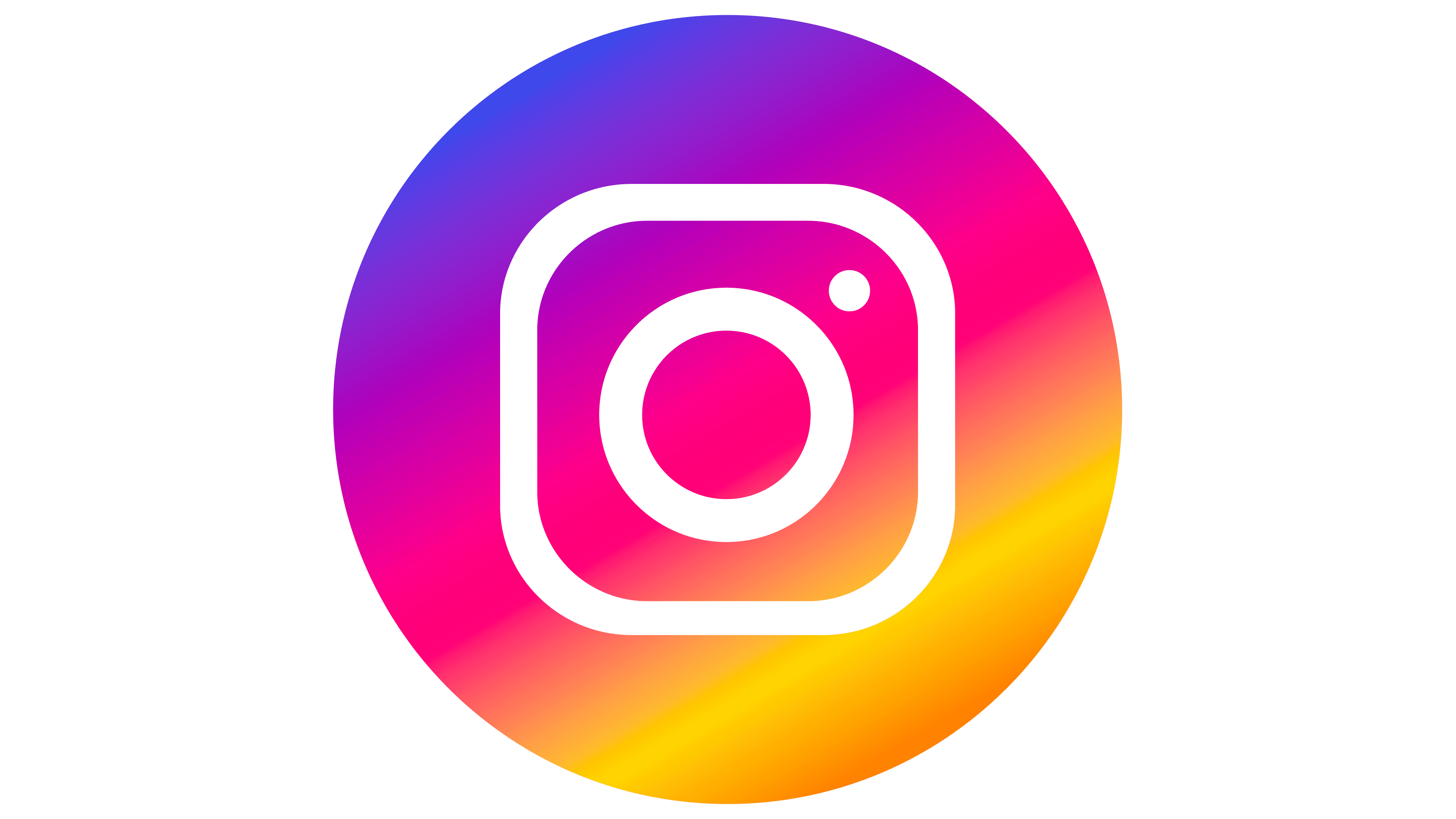AU PAYS DE NOS FRÈRES
Iran années 2000 : dans l’ombre de l’invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans « le pays des frères ». Une odyssée sur trois décennies où Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Leila, une femme isolée et Qasem qui porte le poids du sacrifice pour sa famille, luttent pour survivre à ce nouveau quotidien incertain.
Avant-propos
La vitalité du cinéma iranien n’en finit plus d’étonner. Dans un pays où seuls les films de propagande ont le droit de citer, les cinéastes continuent, de manière clandestine ou en exil, de produire un cinéma de résistance d’une stupéfiante vigueur. Derrière les têtes d’affiche, Jafar Panahi, Mahammad Rasoulof ou Asghar Farhadi (qui a décidé de rester vivre en Iran, mais de ne plus tourner tant qu’il sera contraint de filmer des actrices voilées), de nouveaux noms voient le jour. Au pays de nos frères arrive chez nous deux mois après le très beau Mon gâteau préféré de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha, qui ont choisi eux aussi de rester en Iran malgré les menaces des mollahs (censure, enquête pour propagande contre la République islamique et propagande de la débauche).
Le tournage d’Au pays de nos frères s’est achevé le jour de l’annonce de la mort de Mahsa Amini, qui a initié le mouvement populaire Femme, vie, liberté, au coeur du récit des Graines du figuier sauvage du Mohammad Rasoulof, film primé au dernier Festival de Cannes. La présence de ces films dans les grands festivals favorisent leur visibilité à l’international, tout en mettant les cinéastes en péril dans leur pays. Ainsi Saeed Roustaee et son producteur Javad Norouzbeigui, ont été condamnés à six mois de prison par un tribunal de Téhéran qui les reconnaît coupables de « contribuer à la propagande de l’opposition contre le système islamique » à la suite de la projection du film Leila et ses frères au Festival de Cannes 2022. Bonne nouvelle, Panahi et Roustaee pourraient bien être une nouvelle fois en compétition dans un mois sur la croisette.
Critique du film
L’exil est une question centrale dans la production contemporaine du cinéma iranien, mais Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi ont choisi de la traiter de l’intérieur en s’intéressant aux conditions de vie en Iran des presque sept millions d’afghans contraints à l’exil depuis, au choix : la guerre civile, l’arrivée des talibans, les bombardements américains, le retour des talibans (cette liste est une tragédie sans fin). Déployé sur vingt ans et trois chapitres, Au pays de nos frères décrit la condition d’exilée d’une famille afghane en Iran. Une histoire de violence et de domination où surnage la beauté.

Les fragiles et les faibles
C’est la fin du jour et un homme a attendu que sa femme aille se coucher pour pleurer. Il ouvre le robinet de l’évier pour que le bruit de l’eau couvre ses sanglots. Negin est sourde, elle ne risque pas d’être perturbée mais leur fille dort dans la pièce attenante. Autre temporalité, autre plan, une maison cossue au bord de la mer, vue de l’extérieur à la nuit tombée. Au rez-de-chaussée, un groupe d’amis chante et fait la fête et dans la pièce juste au-dessus, une femme prépare les lits des invités. Il y a aussi ce que l’image ne peut montrer mais que le spectateur sait déjà : un homme gît dans une pièce de la maison bouclée à double tour. Le troisième plan remarquable du film est flou, alors qu’un homme, le regard déterminé, s’avance face caméra rejoindre un adolescent qu’il a forcé à se déshabiller.
Ces trois plans, issus des trois chapitres qui composent le long métrage, illustrent deux motifs essentiels du film, la solitude et le hors-champ. Si la violence qu’ils subissent demeure hors-champ, elle est d’autant plus cruelle qu’elle restera, tout porte à le croire, impunie. Les Hommes sont ainsi faibles qu’ils profitent des systèmes de domination que la société leur donne l’occasion d’exercer et, en Iran, les réfugiés afghans sont condamnés à une forme de sous-citoyenneté. Deux faiblesses se croisent dans le récit, conduit par une ligne claire et sophistiquée, l’une politique, l’autre morale et les deux cinéastes filment leur rencontre, ses conséquences et ses ricochets dans un arc temporel long, troué d’ellipses. Une scène de repas, au milieu du premier chapitre, présente la famille dans son ensemble, ce sera la seule. Par la suite, la narration procède par zooms successifs sur les uns et les autres, zooms si puissants qu’ils isolent les membres jusqu’à la détresse.

Le principe du clou
Mohammad, Leila et Qasem sont tour à tour victimes, mais Au pays de nos frères a beau se présenter dans toute l’ironie de son titre, il repousse sans cesse le piège du manichéisme. Il joue pour cela avec les contrastes et le mensonge. Chacun a une bonne raison de ne pas dire la vérité, car la vérité c’est que se taire est une manière d’invisibiliser la catastrophe, c’est aussi la route la plus courte sur le chemin de la résilience. Le mot est lâché, on le gardait au chaud tant il a été galvaudé mais Au pays de nos frères est davantage un film de résilience qu’un film de combat. C’est ce qui en fait toute sa beauté. Le soin des cadres, l’harmonie des couleurs, la beauté de la bande originale (un thème, piano et violoncelle, exprimant le calme et la solitude, revient comme un baume), tout concourt à restituer, malgré tout, la complexité d’une Humanité blessée.
Le destin de cette famille, est celui d’un clou sur lequel, par facilité, par jeu, par perversité ou par erreur, on tape inlassablement. Et, comme chaque coup de marteau enfonce le clou plus profond dans le bois ou le plâtre, chacune des blessures subie par cette famille l’ancre plus sûrement dans la société iranienne. La dernière scène est, de ce point de vue, exemplaire d’ambivalence et de pudeur.
Bande-annonce
2 avril 2025 – De Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi