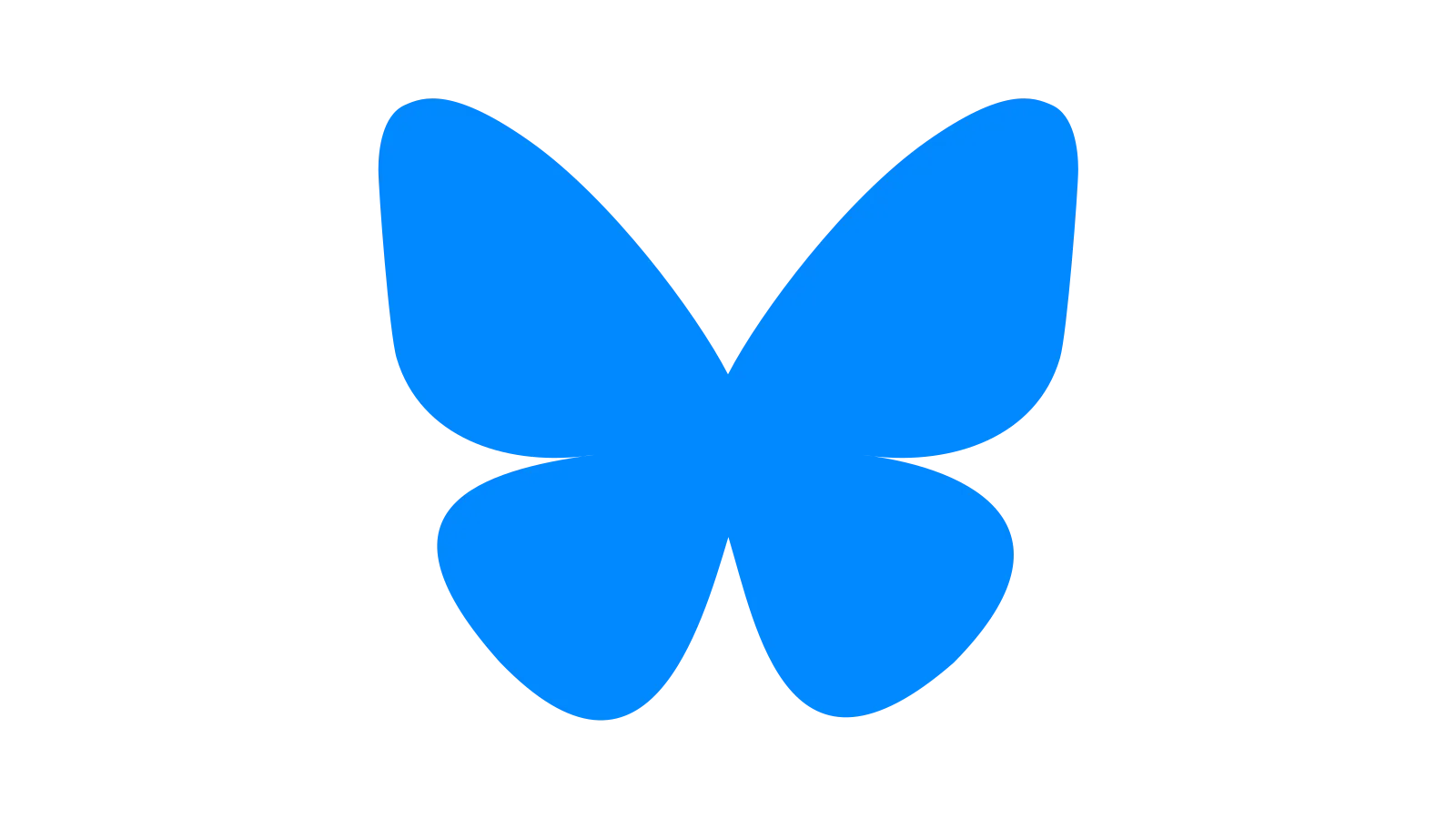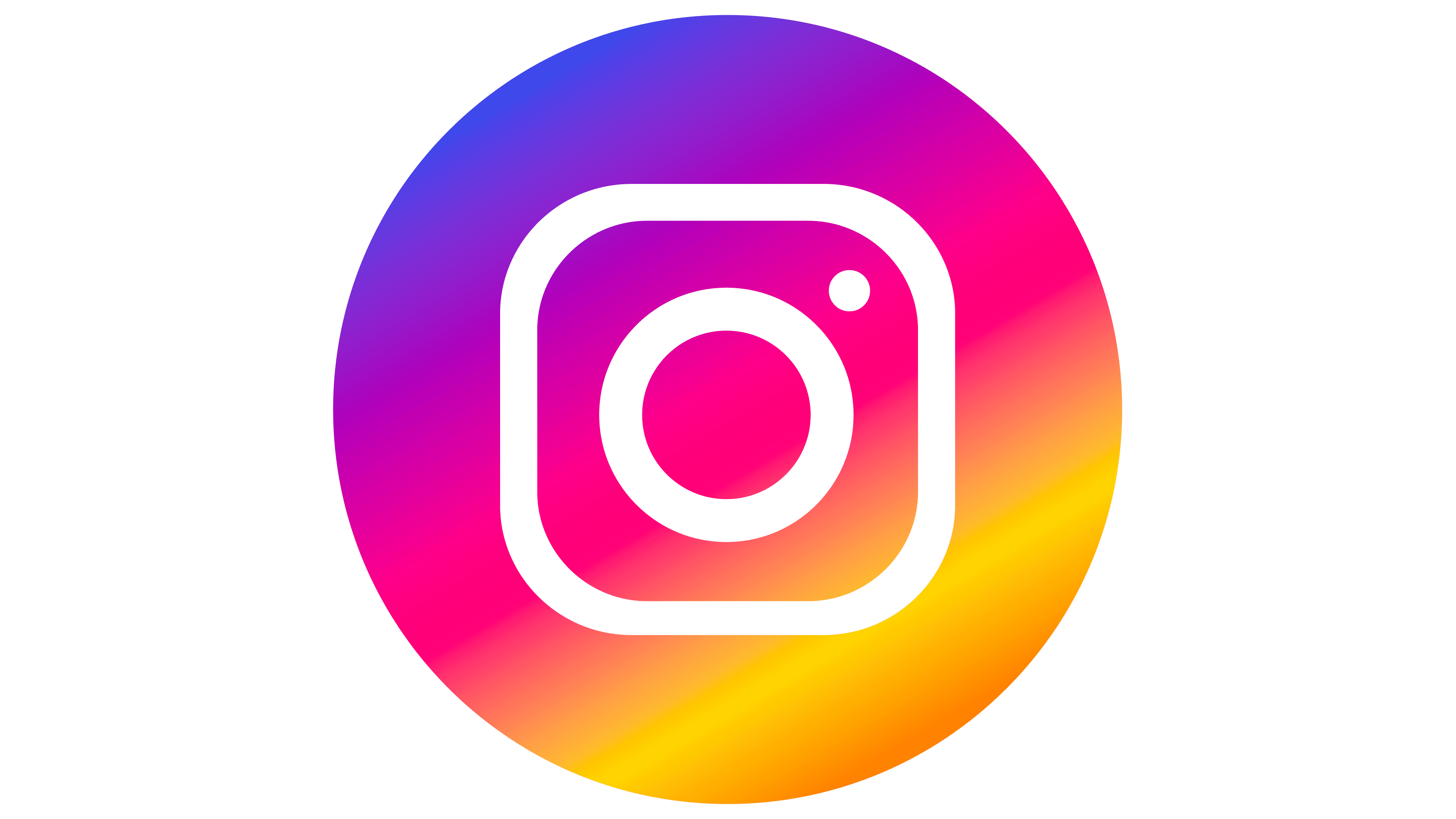CHARLÈNE FAVIER | Interview
Nous avions quitté Charlène Favier sur les bords de la Manche au festival de Deauville, alors qu’elle présentait son premier long métrage (Slalom) dans un contexte sanitaire compliqué, qui avait repoussé plusieurs fois la sortie du film en salle. Nous la retrouvons cinq ans plus tard à Paris, quelques jours avant la sortie de son deuxième film, Oxana, consacré au destin tragique de l’artiste co-fondatrice du mouvement FEMEN.
Un premier film en plein Covid, dont la sortie a été plusieurs fois repoussée, un second film en pleine guerre en Ukraine, sur une personnalité méconnue en France et sans tête d’affiche… On peut dire que vous aimez les challenges ?
Charlène Favier : C’est vrai que c’est un défi de faire un film comme ça ! Mais j’ai tellement été happée par le personnage d’Oksana, que je ne me suis plus posé de questions. On sortait juste du Covid, il n’y avait pas encore la guerre. On a du trouver un autre pays pour tourner le film [la Hongrie] et faire un casting entièrement par Zoom, parce que je ne voulais pas travailler avec des actrices françaises qui auraient appris l’ukrainien, ça n’avait pas de sens.
Au tout départ, les Femen, je suis passée à côté, comme beaucoup de monde. Quand on m’a dit que l’une des fondatrices était une artiste qui avait fait les Beaux-arts à Paris, j’ai commencé à lire des trucs sur elle et j’ai été captivée, comme possédée par cette fille qui était très ambivalente, incandescente, mystique et surtout héroïque, parce qu’elle avait une force et un courage incroyables. Elle était très humble, et c’est pour ça qu’on est passé·es à côté d’elle, parce qu’elle s’est effacée. Elle a été dévorée par sa mission. Du coup, j’ai foncé et j’ai plongé la tête la première pour faire ce film.
Est-ce que ça a été compliqué de trouver des financements ?
Ça n’a pas été simple, mais ça n’a pas été trop compliqué non plus. Je pense que j’ai un peu été aidée par le succès critique de Slalom. Le plus gros défi, c’était remplisse les critères pour pouvoir être subventionné en tant que film français : il fallait autant de temps de tournage à Paris qu’en Hongrie, autant de Français que d’Ukrainiens impliqués dans le film. Une contrainte aussi forte, ça façonne l’écriture d’un film… Mais la genèse, c’est le plus intéressant et le plus grisant à mettre en scène. Le challenge, c’était de faire comprendre pourquoi elles manifestaient seins nus, comment elles se sont rencontrées, qui étaient ces jeunes femmes, et de raconter aussi Paris par leur regard. C’est pour ça qu’on a fini par se dire que cette dernière journée de toute sa vie deviendrait le fil rouge narratif.
Votre film explore énormément de sujets : l’accueil des réfugiés politiques, la manière dont sont traités les mouvements militants (et encore plus les mouvements féministes) et comment ils peuvent être récupérés…
J’ai fait ce film pour rendre hommage à Oksana, mais aussi pour la remettre au centre du tableau, duquel elle a été évincée mais dont elle s’est aussi effacée elle-même. Elle avait cette humilité qui faisait qu’elle ne se battait jamais pour elle-même. Elle se battait contre les injustices dans le monde entier, elle était capable de mettre sa vie en danger, mais elle n’était pas attirée par les projecteurs. Elle le disait, l’activiste doit être anonyme, c’est le message qui est important. Du coup, on l’a oubliée et elle s’est évaporée. C’est ce que j’ai essayé de traduire dans la mise en scène et j’espère que ça marche. À Paris, plus on avance dans cette journée, plus elle s’évapore, plus elle prend de la distance avec elle-même et nous aussi.
Je n’ai pas le courage qu’avait Oksana, mais avec mes petites armes et à ma mesure, j’essaie de porter un message impactant, de dire des choses de l’état du monde et d’initier le débat, comme avec Slalom…
Elle se résigne et elle s’éclipse… Comme une flamme qui se consume très fort et finit par s’éteindre…
Oui, comme vous disiez, je voulais parler de ces mouvements qui disparaissent, qu’on oublie ou qu’on rejette, qu’on n’accueille pas de la bonne manière, parce qu’on ne les comprend pas. Je me suis aussi rendu compte que si elle avait du mal à exister et être comprise, c’est en partie à cause de la barrière de la langue. Elle parlait peu Anglais. Pourtant, elle lisait des grands auteurs de philo, elle en savait beaucoup plus sur le féminisme historique que nous. Mais lorsque tu n’as pas le vocabulaire pour dire ce que tu sais et ce que tu penses, ça devient difficile d’être limitée à quelques mots.

Dans le film, il y a plusieurs répliques d’Oksana qui marquent les esprits, notamment « Tous les mouvements s’essoufflent » ou « l’art c’est la révolution« . Qu’est-ce que ça dit de la liberté de militer et contester ?
J’ai dialogué avec ce personnage en faisant ce film. C’est un peu un cliché, mais quand j’ai commencé ce film, j’étais ignorante. J’ai tout appris en le faisant, même de mon métier. Mais le départ de tout, c’est cette phrase d’Oksana : l’art C’EST la révolution. C’est quelque chose que je partage très fort avec elle. Tous mes films sont militants, ils parlent d’une révolte ultra-nécessaire. J’ai conscience que je suis très privilégiée d’être cinéaste, d’avoir cette chance inouïe. Quand j’étais gamine, on m’a appris que, quand on a des valeurs, on a des devoirs. Quand tu as de la chance, tu essaies de donner aussi. Ma responsabilité, c’était de me servir de cette arme-là (le cinéma), qui est pacifique, pour essayer de faire bouger les lignes. Je n’ai pas le courage qu’avait Oksana, mais, avec mes petites armes et à ma mesure, j’essaie de porter un message impactant, de dire des choses de l’état du monde et d’initier le débat, comme ce que j’ai fait avec Slalom. Je pense que c’est ce qui m’a beaucoup attirée chez Oksana. Je me suis reconnue.
Pour elle, c’était une question de survie. En tout cas, vos films fonctionnent pour susciter la colère, on en ressort enragé·es…
J’aime beaucoup que ça vous fasse cet effet.
C’est terrible, parce qu’on a l’impression que ça ne pouvait pas finir autrement pour elle. Qu’Oksana était un symbole, celui de la combattante, qui s’insurge contre l’injustice, l’autoritarisme, les violences (sexistes, sexuelles, politiques), mais aussi une figure tragique.
D’ailleurs, on le sent un peu au début du film j’espère, dans cette scène de danse autour du feu qui ressemble à un présage. Comme si elle était assignée à quelque chose – sauver le monde ? -, mais que ce sera dur. Ce sera beau, incandescent, mais ça va faire mal et ce sera violent. On sent que ce qu’on lui propose en miroir, la société dans laquelle elle grandit, ça ne lui convient pas.
La société est violente, encore plus pour les femmes…
Alors qu’elles ne l’étaient pas, elles. Leur mouvement est apparu violent parce que leur militantisme était fort. C’est violent visuellement, peut-être…
À la base, les Femen ne sont pas seulement féministes, elles dénonçaient la corruption. Ce n’était pas un mouvement contre les hommes, elles voulaient l’égalité et la justice.
Elles ont essayé de s’adapter au monde dans lequel elles vivaient afin d’attirer l’attention sur ce dont on détournait le regard.
Ce qui m’énerve, c’est qu’on n’a pas compris, moi la première, alors que c’était très intelligent. On n’a pas voulu comprendre. On les a catégorisées et a voulu les remettre à leur place de femmes : des « blondasses » qui « ressemblent à des p*tes » et qui se mettent à poil pour faire passer leur message. On n’a pas compris d’où elles venaient, ce qu’elles avaient affronté…
C’est aussi un problème de traitement médiatique…
Pardon, mais on part en c*illes…
Le terme est bien choisi… (rires) Merci les « grands hommes » de ce monde…
Non, mais c’est vrai, on se demande dans quel monde on vit et comment on a pu tant avancer pour revenir à ce point en arrière ? Ma mère a fait Mai 68, elle a 80 ans et elle a connu cette libération. Avec #MeToo, on s’est libérées à nouveau, et j’ai l’impression qu’on se reprend une claque en plein visage, parce qu’on a encore une fois essayé de s’émanciper, c’est violent !

Ce qui se joue dans le monde et en France, ça redevient très violent pour les femmes, pour toute personne racisée, LGBT… Ça devient invivable et il faut bien trouver un moyen de s’opposer à ça. À ce propos, dans le film, elle a une autre phrase très forte : « l’objet de désir devient un objet de révolte. »
C’est là leur génie. Elles se sont dit que ce corps « objet », qui est un outil de désir dont se servent les hommes, qui les prostituent et couchent avec elles, elles allaient s’en servir comme une arme politique. Au lieu de regarder leurs seins uniquement pour assouvir leurs besoins, ils allaient les regarder pour écouter ce qu’elles avaient à leur dire. Parce qu’à la base, les Femen ne sont pas seulement féministes, elles dénonçaient la corruption.
C’est d’ailleurs très intéressant de raconter comment elles ont trouvé le nom « FE-MEN », dans un moment de légèreté, assez festif, et qui nait d’une volonté d’égalité, de justice.
Oui. Féminin-masculin. Ce n’était pas un mouvement contre les hommes, elles voulaient l’égalité. Et leur révolte, c’était contre l’injustice. Pour la scène du film, je l’ai inventée, mais j’ai lu à plusieurs reprises qu’elles avaient trouvé le nom dans ce bar où elles allaient souvent, quand elles avaient 17-18 ans.
Votre film aura ce mérite de remettre les choses en ordre et le bon regard sur leurs motivations, tout en racontant le destin d’Oksana.
C’est pour ça que je voulais faire le film coûte que coûte. Et j’ai beaucoup appris de mes actrices, elles sont incroyables. Elles ont beaucoup apporté d’elles, de ce qu’elles savaient d’Oksana. On a beaucoup discuté ensemble, c’était une véritable rencontre, très forte. Elles sont incroyables ! Pourtant, elles sont arrivées à Paris dans le même état de traumatisme que celui d’Oksana et ses amies. Elles venaient de subir un an et demi de guerre, elles étaient exténuées psychologiquement. C’est un stress post-traumatique permanent. Faire ce film, ça ressemblait pour elles à une trêve. Mais elles avaient souvent envie de rentrer chez elles, de voir leurs proches pour qui elles s’inquiétaient. Comme Oksana dans le film.
Propos recueillis à Paris le 6 avril 2025