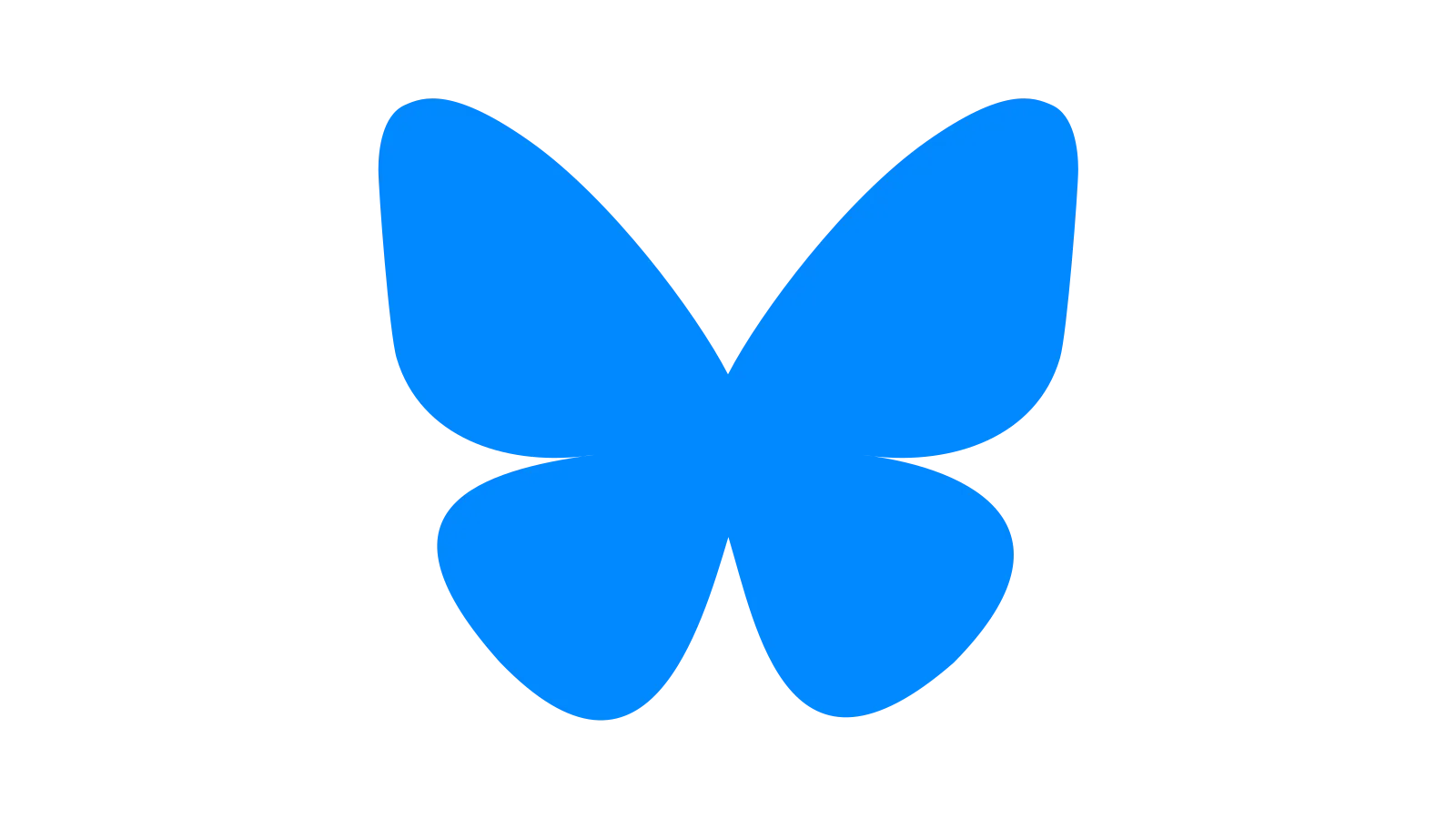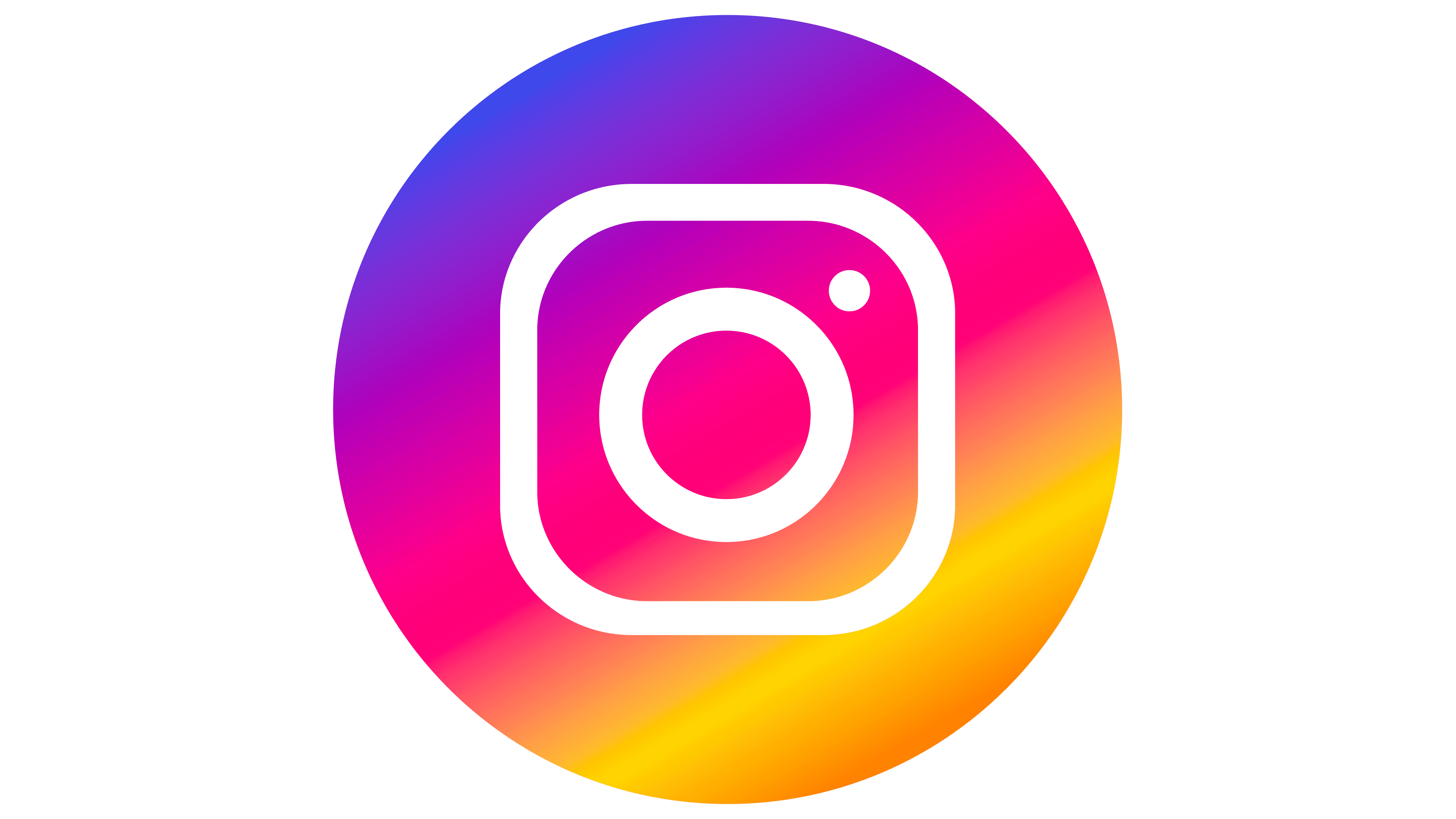À LA LUEUR DE LA CHANDELLE
Au Nord du Portugal, deux femmes partagent leur quotidien depuis 60 ans dans une maison qui semble encore habitée par les générations qui les ont précédées. Présent, passé proche et lointain, cohabitent dans cette demeure imprégnée de souvenirs et de fantômes. Alzira, la maîtresse des lieux, s’est consacrée à un mari austère, renonçant à son goût du piano et de la peinture. Beatriz, la domestique, a dédié sa vie à l’entretien du lieu et aux enfants d’Alzira. Elles sont désormais arrivées au soir de leur vie. Beatriz se plaint de son corps fatigué. Alzira, libérée par la mort de son mari, prend pour la première fois une décision qui n’appartient qu’à elle.
Critique du film
André Gil Mata a suivi les cours de la Film Factory, fondée à Sarajevo par Béla Tarr, dont on sent bien ici l’influence dans le choix de la lenteur des plans, des travellings ou des autres mouvements de caméra. Le réalisateur portugais souhaitait depuis toujours consacrer une oeuvre cinématographique à sa grand-mère et À la lueur de la chandelle constitue le troisième volet d’une trilogie dévolue à cette grand-mère, série de films inaugurée avec le film expérimental House et poursuivie avec le documentaire Captivité.
On ne sort quasiment jamais de la maison, grande demeure qui semble renfermer tous les secrets et toute l’histoire d’une vie familiale dont on devine parfois certaines choses, mais qui reste finalement pleine de mystères. La caméra sort parfois dans le jardin pour nous livrer des visions magnifiées par la photographie de Frederico Lobo. Il y a tout le long de ce film, qui ne ressemble à aucun autre, une étrangeté qui se dégage de la lenteur des mouvements de caméra, mais aussi du caractère obsessionnel de cet oeil du réalisateur qui s’appesantit sur certains objets.

Le cinéaste propose une expérience sensorielle, qui pourra intriguer, fasciner ou irriter, mais qui ne laissera assurément pas indifférent. La mise en scène prend son temps, comme si tout était déjà joué d’avance – on sent que la mort rôde – ou comme si la lassitude d’une vie avait érodé tout espoir et éteint toute flamme. La lenteur des plans fixes et ces plans construits comme des tableaux de maître et la technique du clair obscur, transposée ici cinématographiquement avec beaucoup de style dans des scènes d’une grande beauté plastique, contribuent au plaisir que l’on prend à découvrir cette oeuvre, même si celle-ci tient parfois étrangement le spectateur à distance des personnages.
On retrouve ici le caractère hypnotique du deuxième film d’André Gil Mata, L’Arbre, tourné en 2018 et sorti en France en 2021, ce qui en faisait un des atouts principaux, l’autre attrait étant, comme ici, un grand sens de l’esthétique comme hérité de Béla Tarr, Victor Erice ou encore Ingmar Bergman. À la lueur de la chandelle ne plaira donc pas forcément à tout le monde, mais il s’agit d’un voyage où l’attention du spectateur est immédiatement récompensée par une esthétique splendide et un mystérieux état de sidération devant tant de beauté.
Bande-annonce
9 avril 2025 – D’André Gil Mata