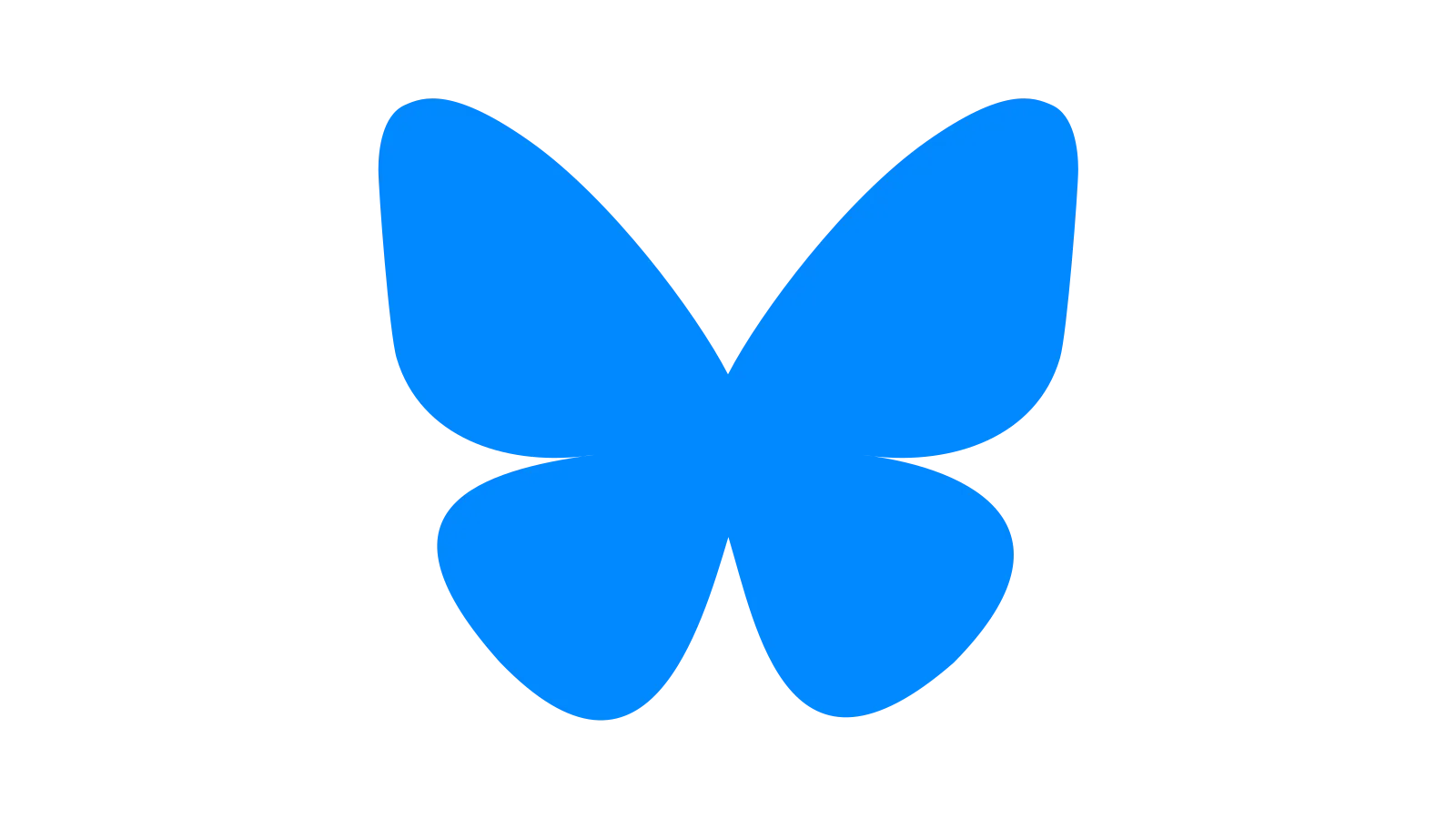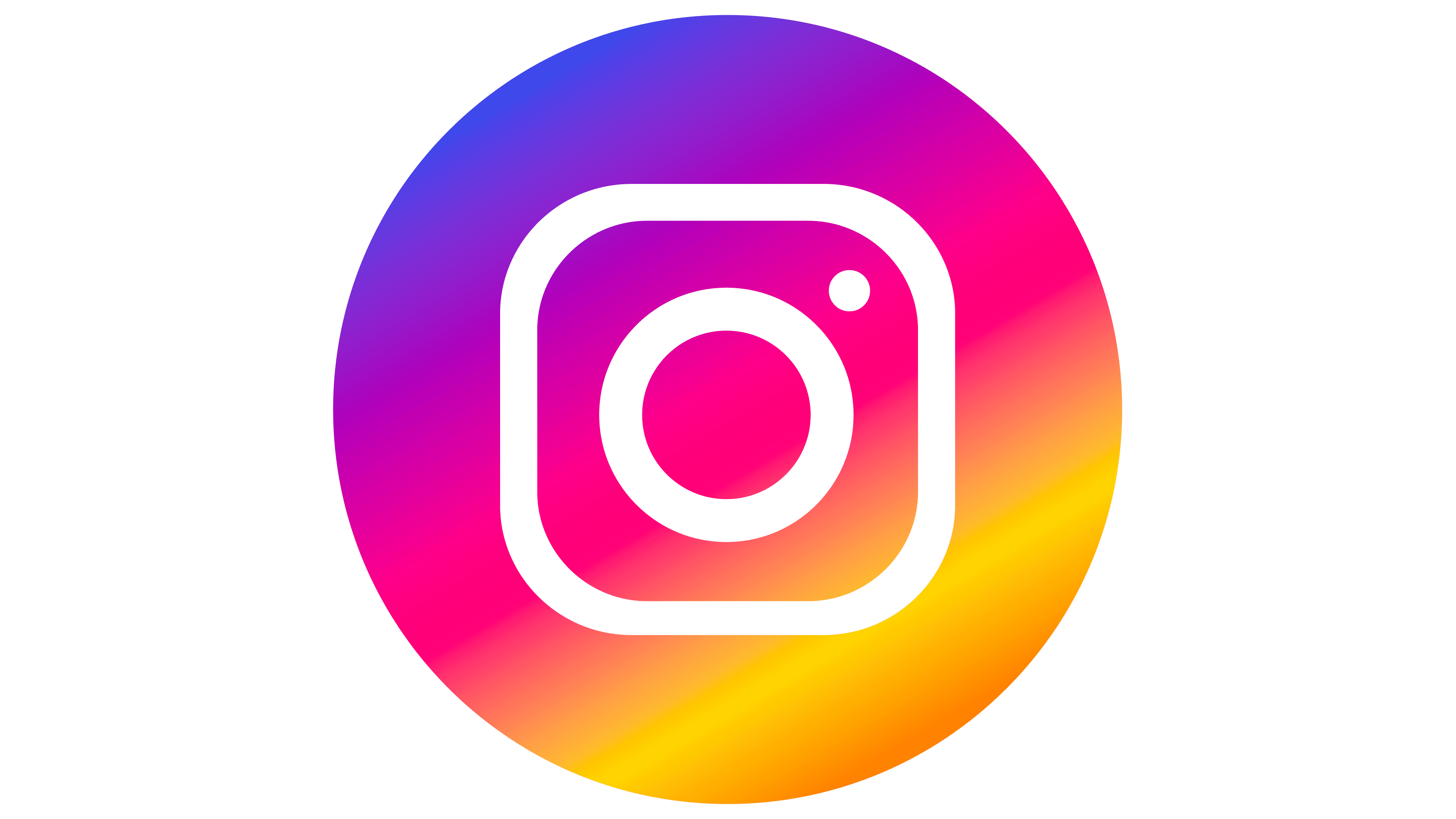COMME LE FEU
Jeff, 17 ans, est secrètement amoureux d’Aliocha. Tous deux admirent le mystérieux Blake, un vieil ami du père de la jeune fille, qui les invite à passer quelques jours dans son chalet de chasse au cœur du grand nord canadien. Là, en pleine nature, les deux adolescents se confrontent à un monde d’adultes puérils, prêt à s’embraser.
Critique du film
Après Les Démons, Genèse et Copenhague – a love story, Phillipe Lesage continue de creuser dans ses fictions le sillon de l’apprentissage. Cette fois-ci les figures de la jeunesse que sont Jeff, Aliocha et Max, forcément au cœur d’un tel sujet, sont mis sur un pied d’égalité avec des adultes. Le feu promis dans le titre, Blake et Albert en sont à l’origine. Deux figures paternelles palliant l’absence de tout référent maternel, deux spécimens pas autant dotés en sagesse que leur expérience le laisserait croire. Qu’il soit spirituel, biologique ou objet de fantasme, le père est donc omniprésent dans ce grand et beau chalet, à tel point qu’il déborde des fenêtres, se glisse sous les portes, s’immisce dans les réflexions pour finir par gâcher la fête.
Après une longue exposition énigmatique, séquence contemplative et sans parole, la première heure du film séduit par une mise en scène et des décors extrêmement soignés. Un sentiment grandissant d’inquiétude émerge à la vue de cette nature sauvage capturée dans toute sa splendeur et son immensité, avant que l’action ne soit circonscrite à l’intérieur du chalet. Ce pressentiment sera graduellement confirmé lors de deux passages sidérants. Entrecoupées de séquences relativement anodines où se côtoient chez les jeunes comme leurs ainés un désir maladroit, une frustration sur le point d’éclater et des espoirs déçus, deux longs plans fixes filmés lors de repas, déchargent une lourde cargaison d’attaques et de ressentiments. Ces scènes sont impressionnantes, filmées avec une précision millimétrée, une parfaite gestion du rythme et une direction d’acteurs irréprochable (Arieh Worthalter et Paul Ahmarani en tête). Elles hissent le film jusqu’à des sommets de tension dramatique et valent à elles seuls qu’on se déplace en salle.

Alors que ce premier segment très maîtrisée voyait se dessiner les enjeux du film, à savoir l’amitié, traitée à tous les âges, à travers des prismes aussi intéressants que les sentiments amoureux, les relations de travail et la compétition virile, la seconde pèche par un mélange de symbolisme appuyé, de motifs datés et d’une durée trop étirée. D’ordinaire, l’arrivée de nouveaux personnages en cours de route est toujours intéressante car elle permet de donner à l’histoire une autre trajectoire, ainsi que des indices inédits. Ici, on réalise que l’insertion à mi-chemin d’un couple d’amis de Blake n’apporte aucune dynamique nouvelle, tout comme certains passages qui s’avèrent gratuits voire carrément embarrassants.
Caractérisée par un empilement de références cinématographiques divers, cette seconde partie déconcerte par un développement trop diffus. D’une séquence à l’ambiance travaillée (la scène de chasse sublimement filmée rappelant celle de Voyage au bout de l’enfer) à une autre toute en spontanéité forcée (la fiesta improvisée au son du Love Shack des B-52’s dont la durée excessive laisse croire à une recherche de séquence clippesque, de « moment youtubable », comme le seraient certains passages des Copains d’abord (Lawrence Kasdan, 1983), on assiste à des scènes formant un ensemble incohérent, tant et si bien qu’il brouille la lecture et les réelles intentions du scénario. Et si celui-ci est capable d’une grande finesse à certains endroits, il souffre parfois d’attributs un peu lourds, surtout quand il réutilise certains codes hipster datés.
Depuis son prénom (masculin) provenant du roman de Dostoïevski (Les Frères Karamazov), jusqu’au moment où elle pleure devant la cheminée (on pense fort à Call me by your name) en chantant en rythme le morceau de la bande-son, le personnage d’Aliocha caractérise cette mouvance tout en manières et en coquetteries faussement authentiques.

Daté également, le fait de filmer une agression sexuelle sans en envisager de conséquences, ce que Lesage avait déjà fait de manière vraiment gratuite dans son précédent film, Genèse. Comme si l’apprentissage de la vie passait forcément par ces moments-là, ou en tout cas ne nécessitait ni rectification ni punition à l’image. À cela s’ajoutent Max ou encore Millie, des personnages inexploités dont on peine à justifier la présence, ainsi qu’une mort qui n’apporte une fois de plus aucune piste aux problématiques esquissées au début.
Comme le feu, riche de trop nombreux sujets et situations pour son propre bien, offrant du grand art comme de l’anecdotique, donne l’impression que toute ou parties de cette histoire a été réellement vécue dans sa jeunesse par Philippe Lesage (alors aspirant réalisateur comme Jeff ?) qui, fort de ses souvenirs forcement marquants, se serait dit : il faut en faire un film. Mais à force de raconter trop de choses, son postulat finit par se diluer, le scénario par s’égarer et le film, par s’étirer et s’étirer encore, comme un feu à qui on aurait donné trop de petit bois à l’allumage et dont les flammes, vite consumées, se transforment progressivement en fumée.
31 juillet 2024 – De Philippe Lesage, avec Arieh Worthalter, Paul Ahmarani et Irène Jacob.