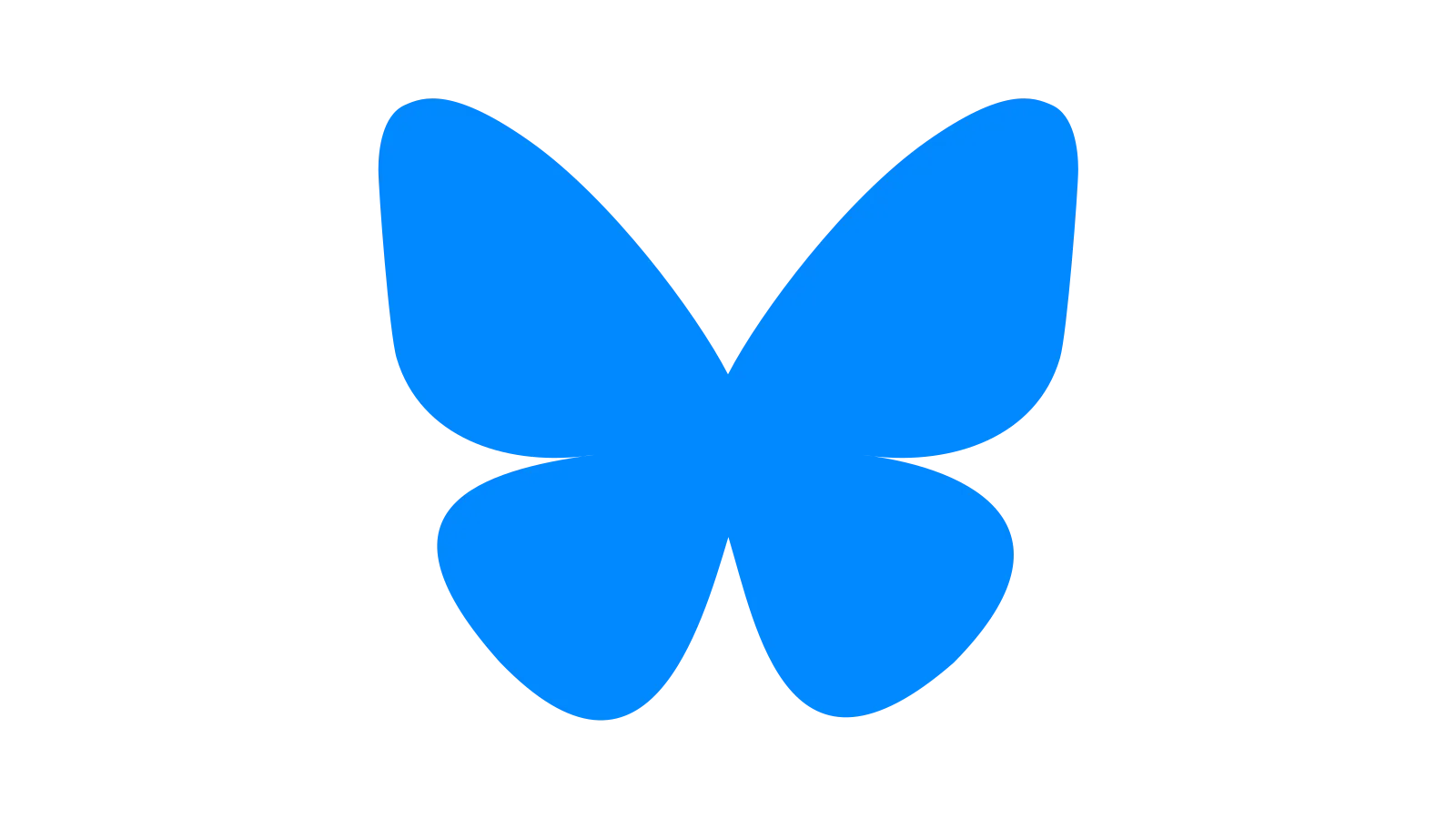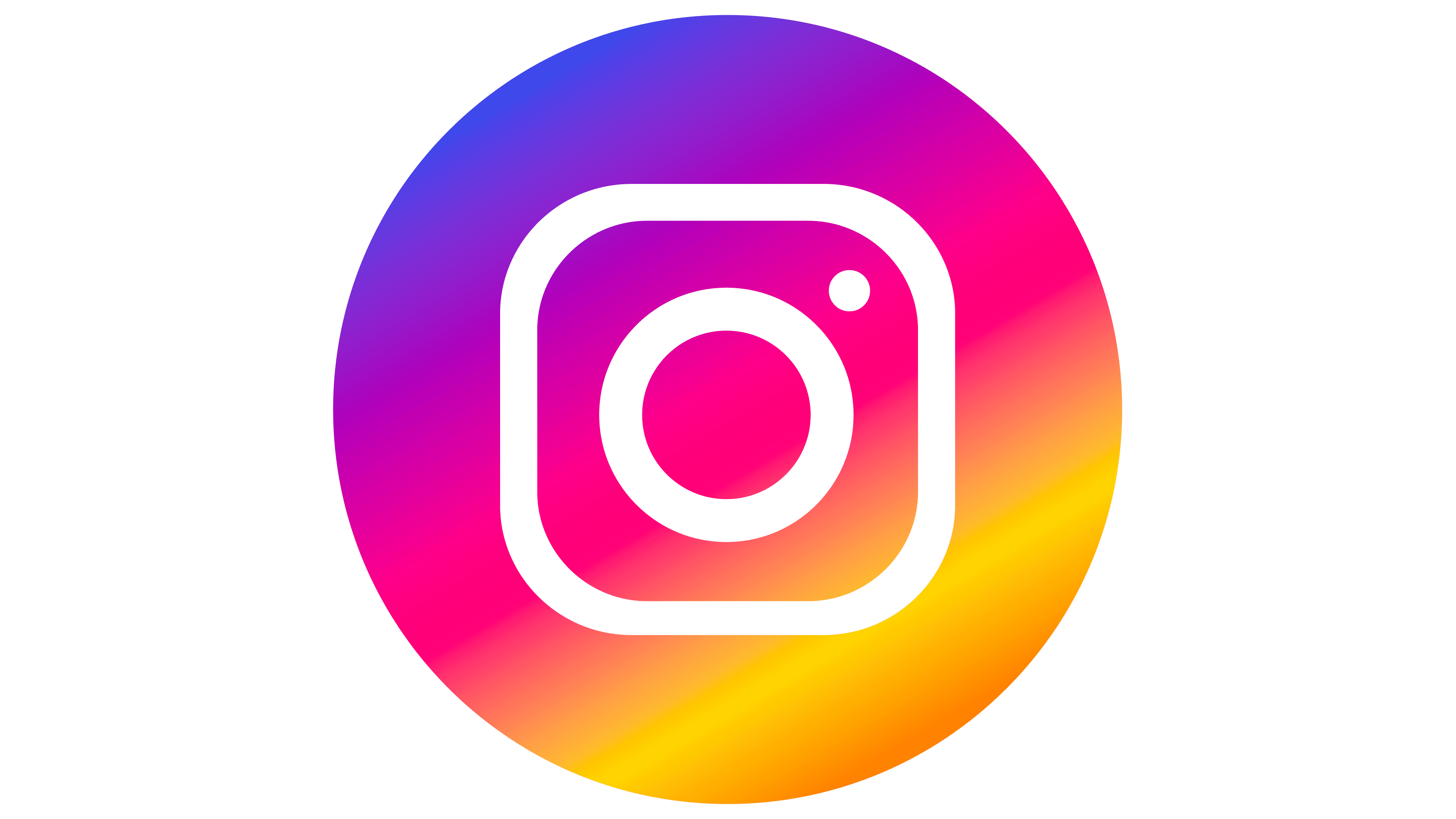JEUNESSE (LES TOURMENTS)
Les histoires individuelles et collectives se succèdent dans les ateliers textiles de Zhili, plus graves à mesure que passent les saisons. Fu Yun accumule les erreurs et subit les railleries de ses camarades. Xu Wanxiang ne retrouve plus son livret de paie. Son patron refuse de lui verser son salaire. Du haut d’une coursive, un groupe d’ouvriers observe leur patron endetté frapper un fournisseur. Dans un autre atelier, le patron a décampé. Les ouvriers se retrouvent seuls, spoliés du fruit de leur travail. Hu Siwen raconte les émeutes de 2011, à Zhili : la violence policière, l’enfermement et la peur. Après d’âpres négociations, les ouvriers rentrent chez eux célébrer le Nouvel An.
Critique du film
Fut un temps où, avant d’être l’usine du monde tant enviée par les autres nations, la Chine était davantage la modeste (mais efficace) fabrique du globe. Si sa mondialisation éclair depuis la fin des années 1980 a acté cette transition, l’héritage de cette période est encore bien vivace dans de nombreuses provinces chinoises. C’est en grande partie ce que Wang Bing s’efforce de dépeindre à travers sa trilogie de la jeunesse, s’étalant sur cinq années consécutives (2014-2019), cette Chine coincée dans un autre temps, comme si son statut de première puissance mondiale ne lui avait jamais été décerné.
L’année 2025 semble donc être celle où les propositions ambitieuses des réalisateurs de la sixième génération du cinéma chinois se concrétisent, entre Les feux Sauvages de Jia Zhangke, Black Dog de Guan Hu, Her story de Yihui Shao, ainsi que le deuxième volet du triptyque de la jeunesse par Wang Bing, baptisé cette fois Jeunesse (Les tourments). Parmi tous ces exemples, l’œuvre de Wang Bing se démarque énormément par on aspect documentaire poussé presque à l’excès. Si le processus créatif semble similaire à celui des Feux Sauvages, Wang Bing s’est attelé à un ouvrage, en réalité, bien plus titanesque.

Son premier volet, Jeunesse (Le printemps), donnait déjà le ton : une œuvre instructive, ancrée dans un réel parfaitement assumé, on y suivait alors le quotidien de plusieurs employés chinois au sein de fabriques textiles. Une vie ponctuée par le bruit incessant des machines à coudre, les salaires misérables et la certitude d’être bien loin de son foyer. Dans Jeunesse (Les tourments), le postulat de départ est en tout point similaire. Wang Bing, presque seul derrière sa caméra, s’infiltre dans d’autres ateliers du Zhili, s’attardant cette fois davantage sur tout ce que cette jeunesse, condamnée à travailler clandestinement pour sa subsistance, endure jour après jour.
Après Jeunesse (Le printemps), la technique de Wang Bing ne surprend plus : avec sa caméra embarquée, le réalisateur suit presque en tout temps, une galerie de personnes bien réelles. La réalité est ainsi filmée dans son plus pur appareil, aucune fioriture si ce n’est le montage, qu’on imagine atrocement laborieux au vu de la quantité d’images récoltées. Une telle méthode permet une porosité inégalable entre ce que le spectateur regarde et ce que le réalisateur a enregistré. La parole est toujours laissée aux intervenants, ils sont d’ailleurs filmés même dans les moments complexes : une négociation aux allures de dispute avec leur supérieur, au sein du dortoir alors que leurs yeux peinent à rester ouverts, même pendant leurs repas.

Si tout cela peut au premier abord sembler relever du voyeurisme, Wang Bing sait exactement ce qu’il souhaite montrer sans jamais tricher. La mise en scène se concrétise par les faits, ces employés tous immigrés des régions reculées de la Chine (abandonnées au profit des côtes, plus prospères) sont très souvent noyés dans les vêtements qu’ils fabriquent, comme dévorés par leurs propres créations qui les aliènent malgré eux. Lorsque les travailleurs négocient une marge mineure sur leur salaire, la caméra s’axe alors sur les visages, montrant la fatale déception quand leur patron leur accorde à peine de quoi survivre. Au milieu de tout ce labeur, les relations sociales dominent, donnant lieu à de véritables émotions à l’écran, chose plutôt extraordinaire dans un médium nous habituant très souvent au faux.
Mais l’ultime victoire de ce deuxième volet se trouve dans ses interstices. Ce qu’il faut comprendre, ce n’est pas tant que Wang Bing filme une quelconque misère humaine ou une pauvreté croissante dans le seul but d’émouvoir. Son documentaire dénonce. Il dénonce les instances d’un gouvernement qui ne fait plus rien pour une partie de sa jeunesse, celle qui forge encore le pays en tant que puissance reconnue, celle qui arrive à la fin d’une fenêtre d’opportunités et qui n’a plus que pour seule mission que celle de se frayer un chemin dans les restes d’une Chine tournée vers l’extérieur au détriment de ses régions intestines. Reconnaissons peut-être aux deux documentaires un certain manque d’accessibilité pour les plus frileux, sa durée et sa structure pouvant forcément faire fuir un (certain) public non averti. Mais à travers ce deuxième volet sur la jeunesse, Wang Bing confirme que le cinéma documentaire peut aussi rester à ses plus simples fondamentaux : se saisir de sa caméra et filmer des existences, qui prennent sens sans aucune artifice.
Bande-annonce