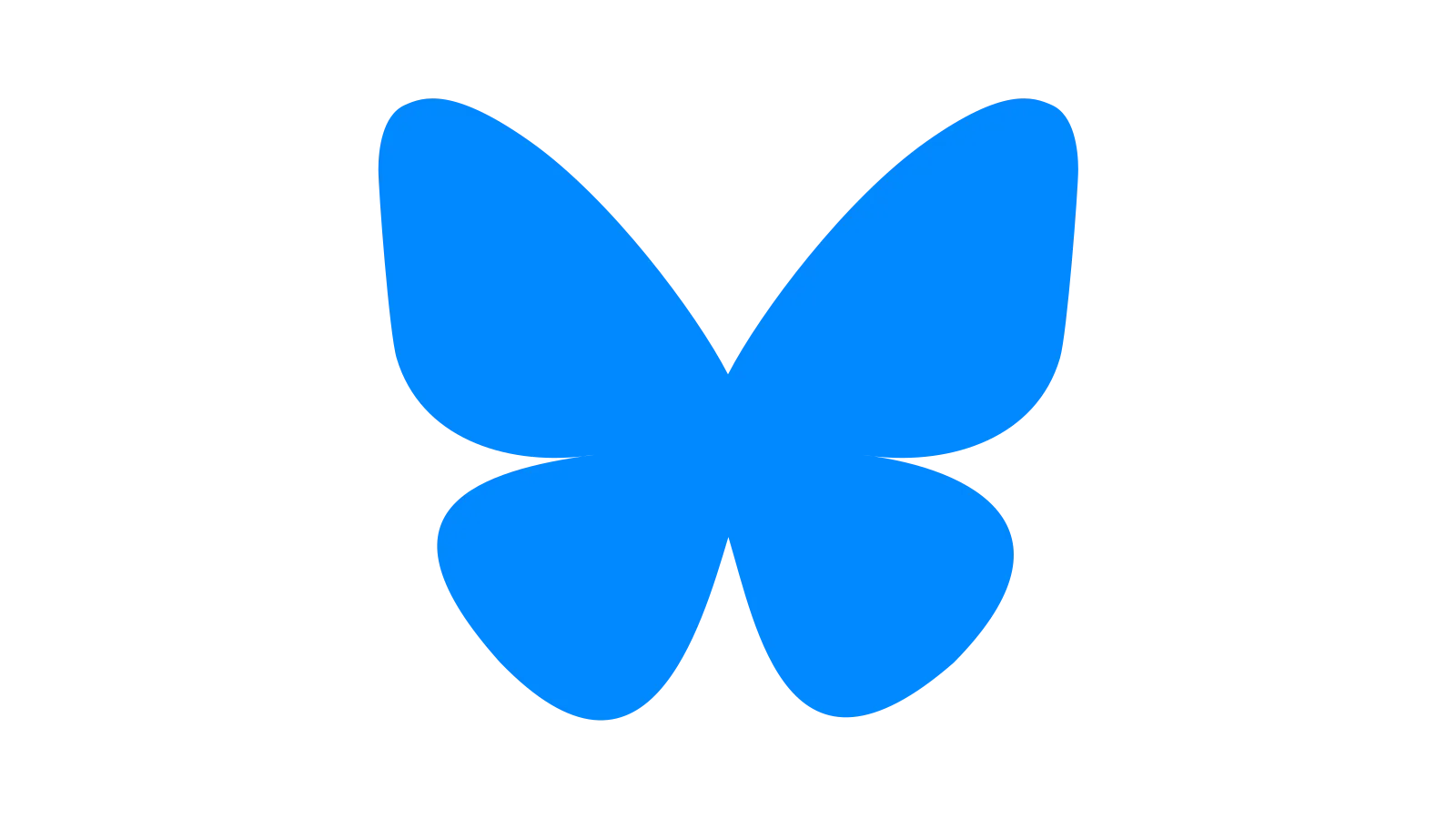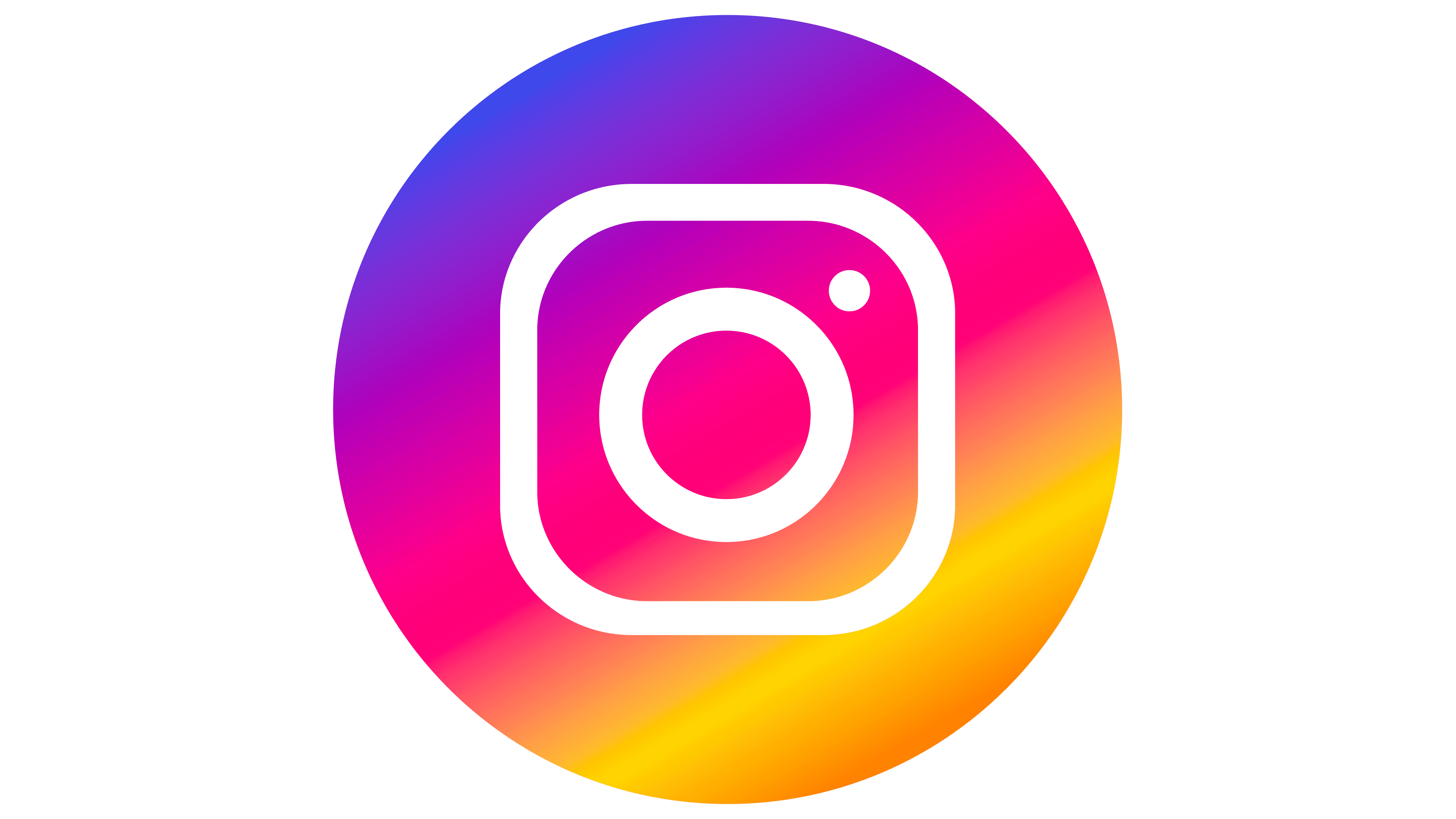LA CHAMBRE DU FILS
Cycle Palmes d’Or
C’est arrivé le 20 mai 2001, Liv Ullmann annonçait que la Palme d’or du 54e festival de Cannes était attribuée à Nanni Moretti pour La Chambre du fils. Melanie Griffith et Antonio Banderas la lui remettaient. Casting parfait. Je ne me souviens pas qu’une annonce de Palme d’or m’ait autant rempli de joie. C’est rare, quand on n’est pas festivalier, d’avoir vu le film palmé avant la proclamation du palmarès. La Chambre du fils était sorti le vendredi 18 mai, lendemain de sa projection cannoise et je l’avais vu le samedi. Il m’avait d’abord surpris, Nanni Moretti amorçait alors un virage dans sa filmographie, puis ému aux larmes. À cette époque, le Festival se clôturait le dimanche de la deuxième semaine et j’avais aimé, aussi, que ce dimanche réponde, comme un ricochet joyeux, à celui, funeste, de la fiction.
La Chambre du fils n’est pas ce genre de film qu’on revoit sans appréhension. Il s’agirait de ne pas gâcher le souvenir ou, pire encore, de reconvoquer une émotion émoussée. Bien qu’y pensant souvent, je ne m’y étais pas risqué. Et puis l’occasion de cette rubrique était trop belle et 24 ans après, il était temps. Notons que Céline Bourdin avait déjà consacré au film, ici, un très beau papier à (re)lire en parallèle.
Complicités
Sept notes de piano, comme les sept jours de la semaine, ouvrent le thème composé par Nicola Piovani. Un air léger empreint, dans sa répétition et ses variations, de la mélancolie du temps qui passe. C’est la première chose qui frappe quand on redécouvre le film : combien cette musique a pénétré une zone profonde de notre mémoire et combien nous l’avons rétrospectivement associée au drame que le film embrasse. Ce même thème, entendu au début ou dans la deuxième partie du film, ne sonne pas de la même manière à nos oreilles. Rendre compte, par petites touches, du travail de la mort au coeur d’une famille, entre ruptures et continuité, c’est toute la force de La Chambre du fils. Plus qu’un bonheur parfait, la première partie s’attache à dépeindre une routine heureuse, ça et là marquée par les contrariétés.

C’est ainsi que, dès la première séquence, le téléphone sonne alors que Giovanni, le père, rentre de son footing. Il est convoqué au lycée pour une histoire de fossile volé avec laquelle Andrea, le fils, aurait à faire. Sans vraiment déstabiliser le cours ordinaire des choses, l’événement trotte dans la tête de Giovanni. Andrea, après avoir nié, finit par avouer le forfait à Paola, la mère. C’était une blague qui a mal tourné. Il aurait voulu soulager sa conscience auprès de son père, la veille, au cours de leur promenade en ville, mais celui-ci semblait si heureux de leur complicité, qu’il n’a pas pu. Si Giovanni avait raison de douter de la sincérité de son fils, il en a toutefois éprouvé une sorte de culpabilité paternelle. Le récit tisse, dans le quotidien de cette famille, un écheveau de sentiments et de d’attachements, fragile équilibre sur lequel viennent se nouer les attachements familiaux les plus forts.
Boucle infernale
Un dimanche matin qu’il faisait beau et que Giovanni tentait de convaincre Andrea de venir courir avec lui, un nouveau coup de téléphone venait chambouler le programme. Au bout du fil, Oscar, un de ses patients suicidaires, appelait à l’aide. Andrea rejoignit alors ses amis pour une sortie en plongée sous-marine et le drame survint, brutal, sec, péremptoire. Nanni Moretti met alors en scène, pour transmettre l’information, une série de regards. Celui de Giovanni dont on comprend qu’il saisit instantanément la gravité de la situation quand il aperçoit devant chez lui les parents des amis d’Andrea. Plus déchirants encore, les regards échangés entre Giovanni et Irene, sa fille. Il la rejoint dans un gymnase où elle participe à un match de basket. Au milieu du vacarme de la salle de sport, leurs deux corps figés rappellent l’instant suspendu de Palombella rossa alors que monte des tribunes la chanson de Bruce Springsteen, I’m on fire.
Quelques semaines plus tard, Irene reprendra la compétition, contestera avec véhémence une décision arbitrale, provoquera une échauffourée générale et sera exclue puis suspendue. Suspension qui fait écho à la mise à pied prononcée par le proviseur du lycée d’Andrea au moment de l’affaire du fossile dérobé. Toutes proportions gardées, c’est le même sentiment de sanction, l’injustice en plus, que la mort d’Andrea suscite, de manière différente, chez Giovanni, Paola et Irene. Cette dernière demande un sursis de quelques secondes pour regarder une dernière fois le corps inerte de son frère dans le cercueil qu’on s’apprête à refermer. Un regard, encore, toujours, hante Giovanni, celui qu’il n’a pas échangé avec Paola, ce dimanche funeste, sans lequel il n’a pas eu la force de repousser son rendez-vous professionnel avec toutes les conséquences que l’on sait, qu’il ne cesse de ressasser. La douleur de Giovanni est aussi une culpabilité en forme de boucle, un enfermement. Ainsi le morceau de musique qu’écoutait Andrea dont il relance ad nauseam un extrait de quelques secondes, ainsi le manège à sensations dans lequel il se laisse secouer (réveiller?) et le retour en arrière qu’il voudrait opérer pour changer le destin.

Giovanni exerce la profession de psychanalyste. Il reçoit ses patients dans un cabinet contigu à l’appartement familial. Aux flots de mots qu’il reçoit à longueurs de journées, souffrances en tout genre étalées, répétées, parfois vociférées dans sa bienveillante écoute, Giovanni ne sait que répondre, lorsqu’à son tour, la douleur le frappe. Son incapacité à verbaliser son chagrin est une forme d’égoïsme dont Paola lui fait reproche avec des mots de plus en plus durs. Irene à son tour, se retrouve impuissante, un matin, après avoir trouvé porte close aux deux extrémités de l’appartement où demeurent silencieux et isolés, Giovanni et Paola. Ce qui les lie à jamais va peut-être les éloigner définitivement. L’édifice familial est fragmenté, la vie abîmée, comme ce cendrier, cette théière, tous ces objets ébréchés que Giovanni ne peut plus supporter. Il voudrait revenir en arrière mais n’a plus assez de recul pour exercer son métier. Il voudrait, comme les sauteurs en hauteur, reculer, prendre une belle course d’élan et sauter l’obstacle, qu’importe le style, rouleau ventral, ciseaux ou Fosbury.
Il faudra l’arrivée d’une lettre pour enrayer cet enlisement. Andrea avait une amoureuse, Arianna. Liaison de vacances qui se poursuivait de manière épistolaire. Relation tenue secrète par Andrea. Cette révélation agit sur Paola comme une éclaircie. Arianna refuse dans un premier temps de rencontrer Paola puis, un soir, sonne à l’improviste chez les Sermonti. C’est un souffle de vie inattendu qui rentre dans le foyer, une bouffée d’air prélude à une séquence finale qui ouvre littéralement la route à tous les possibles. Entre deux mers, la nuit se prolonge et au petit matin, la voiture s’arrête devant le poste frontière de Menton dont le village est, au loin, incendié par le soleil montant. Depuis le bus où sont montés Arianna et son copain de voyage, on regarde les silhouettes de Giovanni, Paola et Irene, s’éloigner sur la plage. Chacun semble prendre sa propre direction. Ils rentreront ensemble à Ancône. Et après ? La vie se poursuivra. Irene marquera d’autres paniers, Paola éditera d’autres livres, Giovanni reprendra sans doute ses footing, ses pas fondus dans la foulée d’une ombre qui ne sera peut-être pas la sienne. Impossible à semer, impossible à oublier. Une course sans vainqueur.