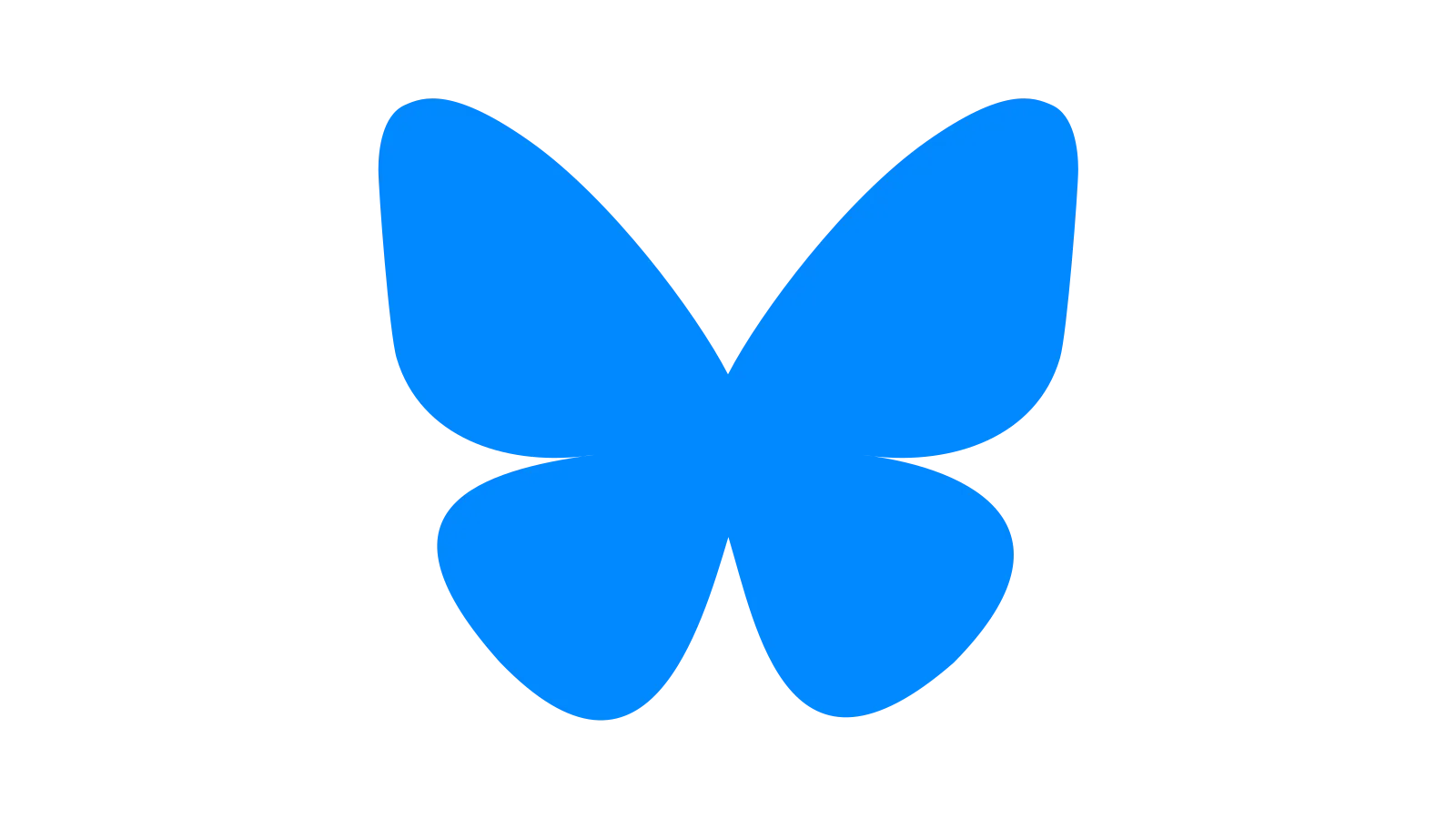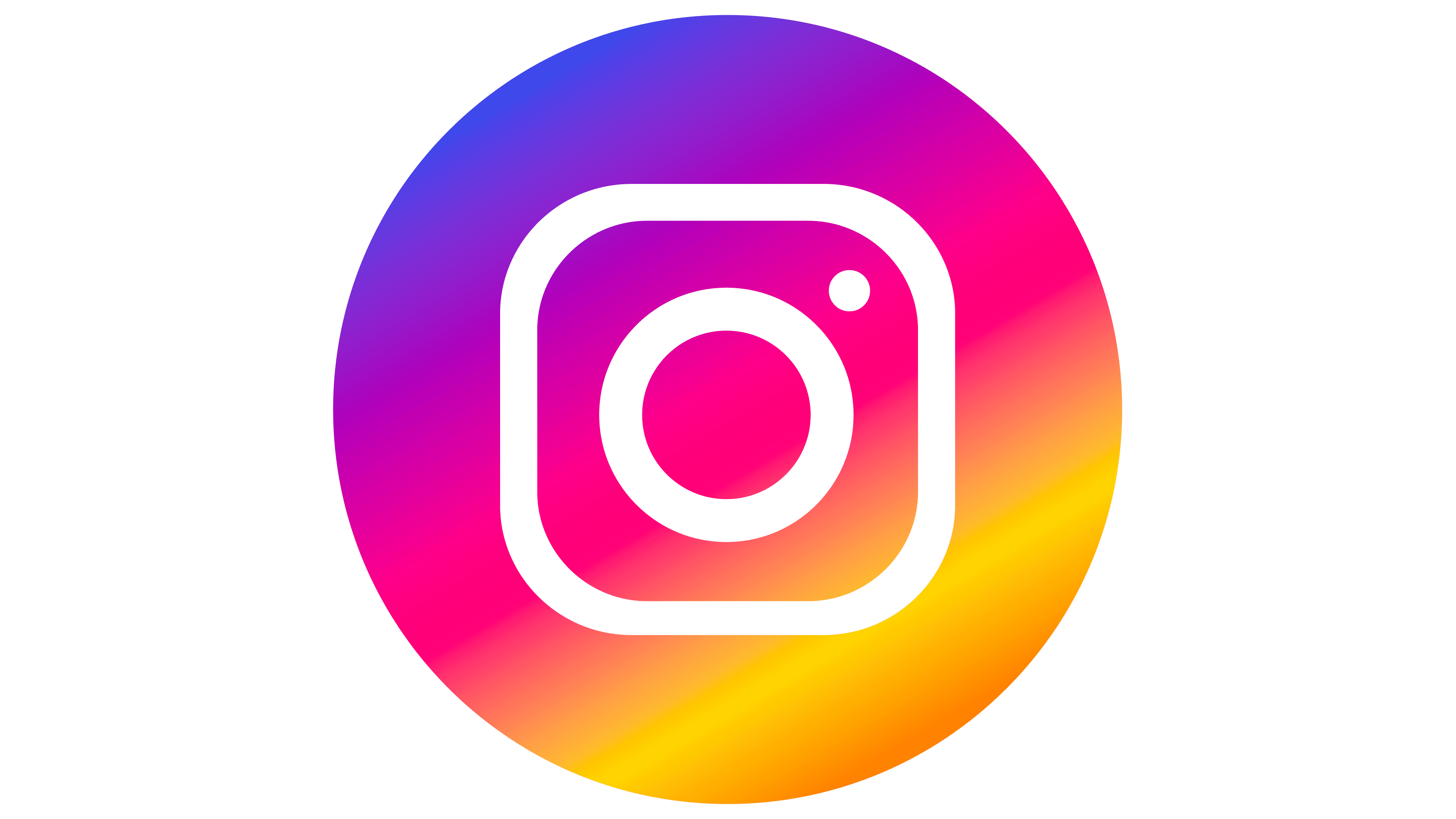THE GAZER
Frankie est atteinte d’une maladie dégénérative qui l’empêche de se repérer le temps. Encline à la paranoïa et sujette à des pertes de consciences fréquentes, elle enregistre des messages sur des cassettes pour se repérer et assurer sa sécurité. Incapable de trouver un travail stable dans son état, en quête d’argent pour récupérer la garde de sa petite fille, elle accepte une mission proposée par une femme aux intentions troubles…
Avant-propos
S’il y a bien un genre n’ayant jamais vraiment quitté les salles obscures, c’est bien celui du thriller. Depuis les grands classiques du film noir aux versions plus contemporaines, sont apparus un ensemble de sous-genres s’attachant chacun à leurs propres codes. Le Blow Up de Michelangelo Antonioni (1966) est à l’origine de l’un de ces plus intrigants, ces longs-métrages que l’on pourrait ranger sous l’étiquette de « thrillers paranoïaques». Entendons par là tous ces films à suspense sans réelle menace à contrario des films au serial killer bien réel ou aux complots à grandes échelles savamment calculés. Rien de tout cela n’est ce qui fait d’un banal thriller une véritable spirale de peur latente, donnant lieu à une sensation d’incertitude constante ; la résultante chez le spectateur et le protagoniste se manifeste au travers d’un doute vis à vis de l’ombre menaçante cachée derrière les images.
C’est ce qui rend le Blow Out de De Palma si unique, lorsqu’on ne sait s’il faut croire ce Travolta persuadé de reconnaître en un bruit de pneu éclaté la détonation d’une arme à feu, ou lorsque le personnage de Memento interprété par Guy Pearce se souvient à peine du but de sa quête, remettant en perspective nos attentes. Mais il s’agit aussi du genre auquel appartient le monstrueux Conversation Secrète, probablement un des meilleurs films de Coppola, qui a su habilement mettre en scène le doute grandissant d’un Gene Hackman complètement brisé par ses découvertes audio-graphiques.
Critique du film
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que Ryan J. Sloan cite tous ces mastodontes comme sources d’inspiration pour son premier long-métrage, The Gazer, au concept particulièrement évocateur : un personnage atteint d’un trouble cognitif l’empêchant d’appréhender correctement la notion du temps, va se retrouver embarqué dans une histoire ébranlant son sens de la réalité tout en ramenant frontalement ses traumatismes passés. La proposition paraît déjà étonnamment alléchante pour le spectateur, plutôt persuadé qu’il sera confronté à ses propres doutes lors du visionnage. Et le pari semble réussi, ou presque.
Produire un long-métrage d’une durée avoisinant les deux heures en ne tournant que lors de son temps libre tout en s’auto-finançant relevait déjà du petit miracle. En cela Ryan J. Sloan et son acolyte d’écriture Ariella Mastroianni (également interprète principale) ont bien du mérite, livrant ici un premier film convaincant à bien des égards, malgré les conditions de sa production.

The Gazer perturbe d’abord par son sens du détail et sa récurrence de motifs parfaitement réfléchie. Dès la scène d’ouverture, on sent des intentions bien précises : la plus visuelle se traduit par une certaine obsession à ne jamais vouloir nous détacher de Frankie, protagoniste du cauchemar dans lequel nous nous apprêtons à nous engouffrer. La caméra ne s’éloigne que rarement de la jeune femme, nous faisant bien comprendre que c’est par son regard que nous observons le monde, ou plutôt, qu’il se déforme sous notre regard incrédule. Cet effet est renforcé par une idée sonore très maligne, s’incarnant en l’existence du gimmick principal de Frankie : sa manie à enregistrer sa propre voix en prévision d’événements à venir. Ses paroles sortant d’un magnétophone hérité des 1970’s renforcent l’immersion dans sa psyché, comme un être omniscient qui aurait accès à chacune de ses pensées. Le processus participe également au suspense, la rupture entre la réalité des faits et ce que Frankie a prévu vocalement en amont n’en étant que plus instantanée.
The Gazer bénéficie d’une méticulosité épatante, surtout pour ce qui est du sens de la perdition. Le trouble de Frankie se révèle être de la dyschronométrie, handicap que l’on pourrait d’abord définir comme une incapacité à se repérer dans le temps, phénomène étonnamment bien retranscrit dans la structure même du film, qui est l’élément qui renvoie le plus au Memento de Nolan. Si l’intrigue paraît au premier abord linéaire, c’est une nouvelle fois dans une avalanche de petites particularités qu’en ressort la substance. À plusieurs reprises, la narration se tord et s’étire, laissant l’étrange impression d’être perdu au sein du cadre spatio-temporel : est-ce un souvenir, un songe ou s’agit-il d’un événement vécu dans un laps de temps dissimulé ? Toutes ces questions reviennent et raccordent constamment nos pensées à celles de la protagoniste.

Dans The Gazer, Frankie devient un véhicule permettant de s’enfoncer dans les méandres d’une conscience personnifiée, venant ainsi justifier les quelques éléments surnaturels ponctuant le long-métrage. La frontière entre le réel et l’imaginaire se brouille d’une manière si cohérente qu’aucune impression de lourdeur ne surgit là où l’on pourrait s’attendre à perdre toute notre incrédulité de spectateur. Le trouble de Frankie possède un second symptôme : la dyschronométrie se qualifie également comme un possible retard dans le mouvement, une sorte de latence entre l’action désirée et son exécution. Cette double signification convient parfaitement à The Gazer, film dans lequel son actrice semble toujours être prise de court, incapable de réagir face à des situations l’éprouvant aussi bien physiquement que mentalement. Le destin possède un coup d’avance sur ses actions, seule une lutte contre elle-même pourra lui donner l’occasion d’agir sur ce qui l’attend, là-bas, derrière les ombres sans formes d’une ville sans repères.
Le seul défaut de cette mécanique bien huilée se traduit par un manque de confiance envers le spectateur. L’écriture mène assez souvent à une résolution limpide des événements, explicitant trop facilement les zones floues pourtant disséminées ça et là dans l’unique but de nous perdre à mesure que Frankie s’égare (on pensera à une certaine séquence, où le fameux magnétophone devient finalement un moyen facile de révéler la moëlle de l’intrigue, dans une sorte de monologue quasiment « méta »). Cette méthode ne colle pas avec les intentions Lynchéennes de The Gazer. Laisser le témoin de cette histoire se forger sa propre version du déroulement des événements n’aurait rien eu de honteux, et maintenir le public entre les crocs voraces de l’incompréhension aurait probablement fait de The Gazer un film à la marque indélébile, dont la science du détail tant vantée ici en aurait hanté plus d’un à posteriori.
Bande-annonce
23 avril 2025 – De Ryan J. Sloan